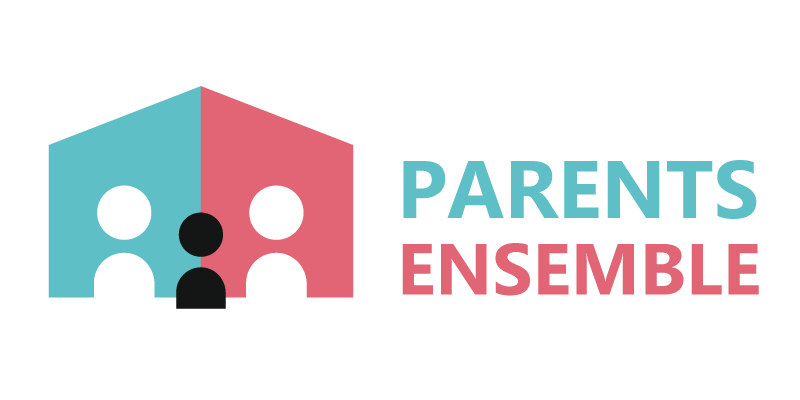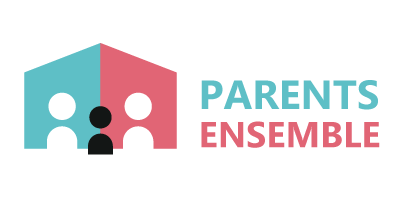À 20 mois, certains enfants utilisent déjà plusieurs mots, tandis que d’autres restent silencieux ou se contentent de gestes. Cette variation surprend souvent, mais elle entre dans une large gamme de développement normal. Le rythme d’acquisition du langage ne suit aucun calendrier universel, même au sein d’une même fratrie.
Les professionnels considèrent généralement qu’un enfant ne disposant que de quelques mots à cet âge ne présente pas forcément un retard inquiétant. Certains signaux méritent une attention particulière et peuvent justifier un accompagnement ou des adaptations du quotidien.
Comprendre les étapes clés du développement du langage à 20 mois
À vingt mois, le développement du langage se construit à un rythme unique pour chaque enfant. Certains balbutient des mots, d’autres s’expriment surtout par des gestes ou des mimiques expressives. Cette diversité n’a rien d’anormal : elle traduit la richesse et la complexité du langage chez l’enfant. Plutôt que de se focaliser sur le seul critère du vocabulaire, il s’agit d’observer l’ensemble des capacités de communication : échanges de regards, tentatives d’imiter, réactions à l’entourage.
Le langage oral s’appuie sur deux dimensions complémentaires : la compréhension (le fameux « langage réceptif ») et l’expression (le « langage expressif »). À cet âge, la plupart des enfants comprennent des phrases simples, reconnaissent des objets familiers, réagissent à leur prénom. Parfois, ils essaient d’imiter les sons, testent différentes intonations, assemblent des syllabes avec plus ou moins d’assurance. La parole n’est qu’une pièce de ce vaste puzzle, étroitement liée à la mémoire auditive, à la motricité fine, à l’environnement social et affectif.
Impossible d’ignorer le poids des interactions quotidiennes. Lire des histoires, chanter, commenter les actions du quotidien, inventer des jeux de langage : chaque occasion devient une rampe de lancement pour le développement du langage chez l’enfant. À l’inverse, un environnement pauvre en échanges ou une exposition précoce aux écrans agit comme un frein.
Voici trois axes principaux du développement à surveiller :
- Langage réceptif : capacité à comprendre les mots, les situations, les consignes simples
- Langage expressif : production de sons, de mots, imitation, désignation d’objets ou de personnes
- Fluence : émergence progressive d’une certaine fluidité, même très embryonnaire, dans la façon de s’exprimer
Parfois, le retard de langage n’est qu’une phase du développement, surtout si l’enfant avance ailleurs : gestuelle, compréhension, sociabilité. Observer l’ensemble de son évolution, sans chercher à tout prix à comparer, permet de mieux apprécier la singularité de chaque parcours.
Mon enfant ne parle pas encore : est-ce vraiment inquiétant ?
À vingt mois, le moindre retard de langage fait naître bien des inquiétudes. Pourtant, chaque enfant avance à sa façon. Certains s’attardent du côté de la motricité ou de la compréhension avant de se lancer dans les mots, d’autres imitent d’abord les sons pour ensuite construire leurs phrases. Il n’est pas rare qu’un retard de langage chez l’enfant ne soit qu’une étape passagère, surtout si l’enfant continue de progresser ailleurs.
La majorité des pédiatres le rappellent : l’absence de mots isolés à vingt mois ne constitue pas, à elle seule, un trouble du langage. Des signaux d’alerte existent toutefois, en particulier lorsque d’autres aspects inquiètent : incapacité à comprendre des consignes simples, absence d’échanges sociaux, ou absence de réaction aux sons du quotidien. Ces éléments peuvent faire évoquer une surdité, un trouble de la communication (comme le trouble du spectre autistique), voire une dysphasie plus rare.
Certains comportements spécifiques doivent attirer votre attention :
- Ne pas assembler de mots à deux ans
- Ne pas comprendre de consignes simples
- Absence de réaction face à des bruits familiers
- Peu ou pas d’échanges de regards ou de gestes
Le mutisme sélectif, souvent lié à une anxiété particulière, peut aussi expliquer une parole absente dans certains environnements alors que l’enfant s’exprime ailleurs. En définitive, il convient de considérer l’ensemble du développement : un enfant qui interagit autrement, comprend, joue et expérimente, ne relève pas nécessairement d’un trouble du développement du langage. L’observation attentive, le dialogue régulier avec un professionnel de santé et la prise en compte des autres sphères du développement restent des alliés précieux.
Favoriser l’émergence de la parole au quotidien : conseils pratiques pour les parents
Pour accompagner le développement du langage, la qualité des interactions avec l’entourage prime sur tout le reste. Chaque moment du quotidien peut devenir une occasion d’éveiller la parole : décrire les actions, nommer les objets, commenter les jeux, répondre aux babillages. Ce bain de langage, riche et varié, nourrit la progression du vocabulaire, de l’écoute et de la compréhension.
La lecture de livres adaptés offre un terrain d’exploration incomparable. Imagiers, albums illustrés, petites histoires du soir : tous ces supports éveillent la curiosité, enrichissent le lexique et habituent l’enfant à la structure des récits. Les comptines et chansons, grâce à la répétition et au rythme, renforcent la mémoire sonore et l’articulation. N’hésitez pas à inviter l’enfant à mimer, à compléter les phrases ou à montrer les images du doigt. Les jeux d’imitation, téléphoner, cuisiner, soigner une peluche, sont eux aussi de formidables leviers pour le langage expressif.
L’exposition aux écrans mérite d’être strictement limitée avant trois ans, conformément aux recommandations des spécialistes. Les échanges directs, nuancés et porteurs d’affect, s’avèrent bien plus bénéfiques pour la construction du langage oral.
Dans certains cas, introduire des gestes ou signes inspirés de la langue des signes pour bébé facilite la communication. Loin de freiner l’apparition des mots, ces outils peuvent même accélérer l’expression et apaiser les tensions liées à la frustration. L’encouragement, l’écoute attentive et la valorisation de chaque tentative, même non verbale, renforcent la confiance de l’enfant et son désir de s’exprimer.
Quand consulter un spécialiste et quels signes doivent alerter ?
Repérer un retard de langage chez un enfant de 20 mois nécessite de prêter attention à certains signaux. Si l’enfant ne prononce aucun mot, n’essaie pas d’imiter ou ne répond pas à son prénom, il est temps de solliciter l’avis d’un pédiatre ou d’un orthophoniste. Les bilans réalisés lors des visites médicales constituent un premier point de repère, mais l’appui d’un professionnel du langage devient précieux si l’évolution semble stagner.
Voici les situations où une évaluation spécialisée s’impose :
- Pas d’association de mots après 24 mois
- Absence de compréhension des consignes simples
- Peu ou pas de réaction aux bruits ou à l’environnement sonore
- Régression dans l’utilisation du langage ou des gestes
- Désintérêt marqué pour les échanges avec autrui
Derrière le terme trouble du langage se cachent plusieurs réalités : surdité, trouble du spectre autistique, mutisme sélectif ou encore dysphasie. Si l’enfant ne progresse pas malgré des sollicitations régulières, il doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement sur mesure. Les structures telles que les CAMSP ou les PMI offrent des suivis adaptés et pluridisciplinaires, parfois indispensables pour établir un diagnostic précis.
Une thérapie orthophonique propose des exercices ciblés sur l’articulation, la compréhension et la production orale. En cas de doute sur un mutisme sélectif ou un trouble anxieux, une consultation auprès d’un pédopsychiatre peut s’avérer pertinente. Un dépistage précoce, serein et sans dramatisation, permet souvent de mettre en place des solutions qui ouvriront la voie à de vrais progrès dans le développement du langage.
Face à ces interrogations, chaque mot prononcé, chaque échange, chaque tentative de communication devient une victoire silencieuse. Les trajectoires ne se ressemblent pas, mais l’accompagnement attentif et bienveillant trace toujours un chemin vers la parole.